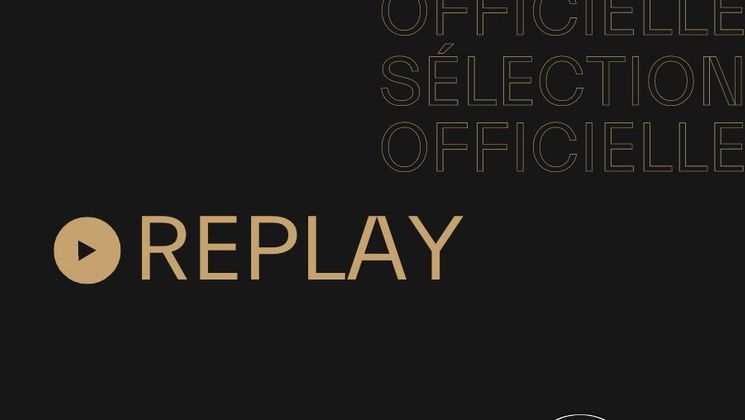Aala Kaf Ifrit, rendez-vous avec Kaouther Ben Hania

Remarquée à l’ACID à Cannes en 2014 avec Le Challat de Tunis, la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania signe son deuxième long métrage, Aala Kaf Ifrit (La Belle et la Meute), présenté à Un Certain Regard. Dans un climat post-Révolution, le film retrace le parcours d’une jeune femme violée qui mène un combat acharné pour obtenir justice.
Comment avez-vous eu l’idée de réaliser ce film ?
Mon film est librement inspiré d’un fait divers qui a secoué la Tunisie en 2012. Il s’agit du périple d’une jeune femme violée par ceux qui sont censés la protéger, des policiers, et qui décide d’aller jusqu’au bout pour porter plainte. Malgré le harcèlement, la pression et les accusations qu’elle a subis, elle a finalement obtenu gain de cause. J’étais en admiration devant cette femme qui s’est révoltée contre la violence policière et s’est transformée en une héroïne des temps modernes. Elle représente la transition démocratique qui se profile en Tunisie. Le pays a besoin de gens comme elle, qui se battent pour leurs droits et qui obligent le système à s’ajuster pour donner lieu à une démocratie naissante. Néanmoins, l’intrigue va au-delà du contexte historique tunisien car j’ai tenu à ce que le propos de mon film soit universel.
Pouvez-vous nous décrire l’atmosphère du tournage ?
Le film est composé de neuf plans séquences. Cela nécessite une grande rigueur pour obtenir une dizaine, parfois une quinzaine de minutes de tournage ininterrompu où tout fonctionne. L’adrénaline est le mot que je choisirais pour décrire l’atmosphère du tournage. Personne n’avait le droit à l’erreur car la moindre faute, hésitation ou tracas technique impliquait que l’on recommence tout depuis le début.
Quel regard portez-vous sur le cinéma tunisien ?
Depuis la révolution, la Tunisie est un pays en chantier. C’est une jeune démocratie où la liberté d’expression est une pratique quotidienne. Cette liberté fraîchement acquise a permis l’émergence d’une génération de cinéastes qui osent des œuvres d’une grande singularité, comme leur présence récente dans les grands festivals en témoigne. Cependant, il reste beaucoup de travail à faire au niveau politique et législatif pour accompagner cette effervescence et financer ces talents en vue de permettre une réelle continuité de la production cinématographique tunisienne, très modeste en termes de nombre de films.
Pouvez-vous nous parler de votre prochain projet ?
Je suis en train de développer un long métrage qui s’intitule « L’homme qui avait vendu sa peau ». Le film raconte l’histoire de Sam Ali, un syrien réfugié à Beyrouth, qui accepte la proposition d'un célèbre artiste contemporain américain. Il passe alors du statut de "sans papiers" à celui d'œuvre d'art internationalement désirée, qui lui permet de circuler librement. Du Louvre aux galeries new-yorkaises, en passant par l’enfer de l’État Islamique, Sam Ali traverse le monde et tente de sortir de ce piège pour regagner l’estime de la femme qu’il aime. Il s’agit d’un récit fragmenté et polyphonique qui mêle plusieurs styles et matériaux. C’est un projet ambitieux qui a besoin de financements pour être concrétisé.