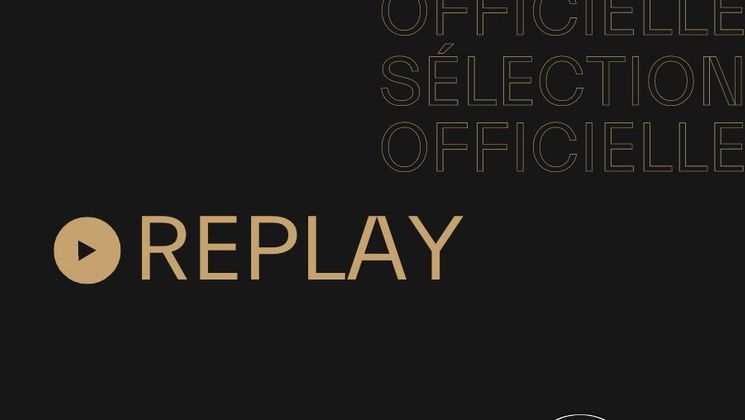I Know Where I’m Going! savoureuse comédie sentimentale

Natacha Thiéry, enseignante-chercheuse et réalisatrice, est auteur de Photogénie du désir : Les films de Michael Powell et Emeric Pressburger, 1945-1950. Elle offre son point de vue ciblé sur I Know Where I’m Going! (1945), une comédie sentimentale profonde et enlevée qui rappelle les meilleures comédies américaines à la Lubitsch. À redécouvrir à Cannes Classics.
Où se situe Je sais où je vais ! dans la filmographie de Michael Powell ?
Ce film est le septième co-signé par Powell et Pressburger sous la bannière des Archers, leur compagnie de production créée en 1942. En attendant de disposer de la pellicule Technicolor réquisitionnée pendant la guerre et qui était nécessaire au tournage d’Une Question de vie ou de mort, Powell et Pressburger imaginèrent l’histoire d’une jeune femme qu’une tempête empêche de rejoindre son riche fiancé à Kiloran, une île des Hébrides où elle doit l’épouser. Le scénario de Pressburger fut prêt en quelques semaines. Quant à Powell, il trouva avec ce film essentiellement tourné en extérieurs (fin 1944) une nouvelle occasion de mettre en scène sa passion pour les îles et pour une nature dont la force impérieuse devenait la projection des tourments intimes des personnages.
À quoi tient la magie de ce film ?
Je sais où je vais ! est marqué de l’empreinte des légendes populaires pour lesquelles Pressburger s’inspira de Walter Scott, d’Edgar Allan Poe, de récits séculaires des Highlands et de superstitions locales. Elles trouvent dans ce paysage puissant et dans le « génie du lieu » écossais, le terreau idéal où prospérer. Ici le rapport de l’individu à son environnement est intensément dramatisé et la prégnance des superstitions et des légendes est telle qu’elle imprègne le récit d’une atmosphère fantastique et donne au film la structure d’un conte. Dans cette histoire d’amour, le récit légendaire est intégré dans une dialectique de l’amour fidèle et de l’illusion amoureuse. Car le film est la mise en scène d’une méprise, et de la résistance d’une jeune femme au désir et au sentiment amoureux. Quant à Torquil, en renouant avec la bravoure du prince norvégien de la légende de Corryvreckan, il incarne l’héroïsme de l’amour courtois. Ce film subtil et savoureux est d’une grande élégance narrative et esthétique.
Quelles sont les valeurs mises en avant par le film ?
Les derniers soubresauts de la guerre avaient vu apparaître des aspirations que les Archers récusaient, en particulier une tendance au matérialisme qu’incarne ici Joan Webster. La jeune femme déterminée découvre à Port Erraig, pointe de l’Écosse, des paysages et des mœurs nouveaux pour elle, faisant ainsi l’expérience d’un parcours initiatique. Confrontée à d’autres valeurs, immémoriales, et à d’autres rythmes que ceux d’une vie urbaine frénétique dont s’amuse Powell au début, ses certitudes sont progressivement ébranlées. Le réalisme et la précision avec lesquels Powell filme les habitants de la communauté, sans ironie ni exotisme, se mêle à une dimension poétique. L’idéalisme romantique et la tendresse de son regard sur une communauté unie par des valeurs humanistes inspirent ici à Powell de magnifiques séquences. À travers un portrait de femme, ce sont les choix moraux de l’après-guerre qui sont dessinés, perceptibles notamment dans le rapport des individus à l’argent : contre la vanité du matérialisme, Powell et Pressburger défendent ici une alternative fondée sur des valeurs telles que la bonté, le partage et une certaine forme d’hédonisme et qui sont le vecteur de l’éveil spirituel de Joan.
Pouvez-vous nous parler des défis techniques et du travail esthétique sur ce film ?
Comme pour A Canterbury Tale, le chef opérateur allemand Erwin Hillier donna à l’image une qualité particulière, utilisant toutes les ressources des ombres et des lumières. Hillier employait des éclairages expressifs du type low key, privilégiant des contre jours et des ombres chinoises découpées contre la mer ou le paysage écossais. Il aimait les atmosphères crépusculaires et cette « heure magique » où la lumière se métamorphose et dessine des contours presque irréels, traduisant subtilement le trouble ressenti par le personnage féminin. De son chef opérateur, Powell disait qu’il possédait « un œil aiguisé pour les effets et les textures ». Sans parler des effets spéciaux dus à Walter Percy Day, qui avait travaillé pour Cecil B. DeMille, et auquel Powell eut recours pour la spectaculaire séquence du tourbillon marin, l’acmé dramatique du film. Powell raconta que pour réaliser cette gageure technique, il monta ensemble des plans en studio et des plans d’un véritable tourbillon, pour lesquels il risqua sa vie en étant attaché au mât de son embarcation, comme le prince norvégien de la légende !