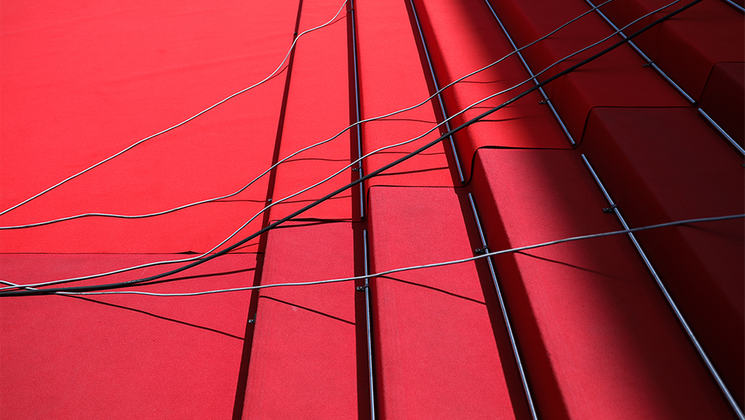Rencontre avec Tahar Rahim, membre du Jury des Longs Métrages

Son talent et ses choix cinématographiques ont fait de Tahar Rahim une vedette prisée des cinéastes en Europe, en Amérique et en Asie. Depuis son rôle dans Un Prophète de Jacques Audiard, Grand Prix à Cannes en 2009, l’acteur français a rigoureusement choisi ses rôles et continue à s’ouvrir à d’autres registres. Aujourd’hui membre du Jury, il sera bientôt à l’affiche d’une comédie musicale, Don Juan, de Serge Bozon.
Quel souvenir gardez-vous de votre venue à Cannes en 2009 ?
J’ai un souvenir assez fort de la montée des marches, j’étais le seul à être en folie. Les marches me paraissaient aussi grandes que celles d’un temple. La veille, je marchais sur la Croisette comme un lambda et, en sortant de la projection, je suis rentré à pied et je me faisais arrêter tout du long. C’est un souvenir marquant parce qu’il est très agréable et il montre à quel point le Festival de Cannes, en deux heures et demie, peut transformer une vie artistique.
Que vous apprend ce rôle dans le Jury du Festival ?
C’est comme si j’allais au cinéma à Paris sauf que je suis avec des cinéphiles qui connaissent profondément leur travail. Ce qui est intéressant, ce sont les discussions à la sortie, avec neuf sensibilités, regards et expériences différents. C’est comme un travail pratique d’école de cinéma. Nos échanges peuvent nous permettre de penser un film différemment, alors que seul, il y a des prismes qu’on atteint avec le temps ou qui ne sont pas les nôtres.
Quel rapport aviez-vous au cinéma dans votre jeunesse ?
Quand j’étais petit, le cinéma, c’était une sortie. Je viens d’une cité ouvrière, d’une grande famille, à Belfort. Enfant, dans les années 1980, je voyais Les Goonies, Stand By Me, tous ces films qui m’ont marqué, Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme aussi. Le premier instant fort de cinéma que j’ai vécu, ce n’était pas en salle. C’était notre prof d’anglais qui nous faisait voir des films. Un jour, il nous a montré La Nuit du chasseur. Normalement, à 12 ans, les films en noir et blanc, on passe à côté. Mais là, je trouvais ça tellement beau, c’était presque comme un conte. Il y avait les rendez-vous à la télé aussi. J’aimais beaucoup Belmondo. Je me souviens avoir pleuré dans Le Professionnel quand il meurt parce que je pensais qu’il était vraiment mort. Je pleurais à chaudes larmes, ma mère est venue me réconforter en me disant : « Mais non, il n’est pas mort pour de vrai, c’est du cinéma ». C’est elle qui m’a fait comprendre que le cinéma était l’art du faux.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ?
C’est plutôt la salle. J’aimais l’endroit, je m’y sentais bien, presque hors du temps. Le son n’est pas le même, qu’il vienne de l’écran ou que tu entendes une personne ouvrir un paquet de popcorn, la feutrine des sièges, la température… À force d’y aller, les films s’imprégnaient en moi. Je voulais de plus en plus être à l’image. Cette envie s’est transformée en passion puis en besoin, et c’est à 17 ans qu’un ami me fait découvrir Taxi Driver et c’est comme ça que je découvre le nouvel Hollywood et que je tombe complètement amoureux de ce genre parce que je m’identifie entre autres alors que je ne me reconnaissais pas dans le cinéma hexagonal. Je retrouve des gens qui sont mes voisins. Les complications de leur vie, leurs origines sociales me parlent. C’est un puissant coup de cœur qui cimente mon envie de faire ce métier.

Mélanie Laurent, Tahar Rahim et Mylène Farmer - Membres du Jury des Longs métrages © Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Qui de l’homme ou de l’acteur a le plus influencé l’autre ?
Avant, je ne puisais que dans mon expérience personnelle. J’avais une difficulté à aller vers les personnages, je préférais les rattacher à moi. Effectivement, quand je deviens père, je nourris l’acteur, ça ouvre des chakras émotionnels que je ne soupçonnais pas. Aussi, certains personnages vous nourrissent. Le personnage de Mohamedou Ould Slahi que je joue dans Le Mauritanien a nourri l’homme en profondeur, de par sa philosophie, sa grandeur, sa force du pardon, tout ce que je n’aurais pas pu saisir à mon jeune âge si je ne l’avais pas traversé à travers lui. J’ai l’impression d’avoir pris un raccourci de huit ans.
Après Le Mauritanien, la prochaine fois qu’on vous verra au cinéma, ce sera en chanson, dans Don Juan de Serge Bozon. Comment vous êtes-vous préparé à un tel rôle ?
Je l’ai pris comme un challenge sportif où je sentais que je pouvais faillir. Le fait de devoir chanter m’a excité, j’ai dû beaucoup m’entraîner. Certains savent chanter de manière innée, ce n’est pas du tout mon cas. Je me suis entraîné pendant deux mois. Trois fois par semaine, j’ai pris des cours avec les compositeurs et en parallèle avec une prof de chant pour approfondir la technique.
Vous rêvez d’explorer un autre registre en particulier?
Le western. Je rêve de faire un western. La comédie musicale, j’avais dit que je voulais en faire une il y a quelques années. Voilà. Mais le western, j’en rêve.