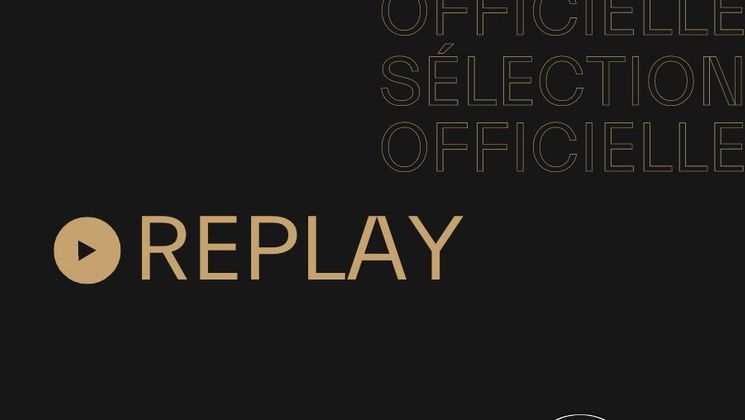Voyage à Tokyo, quand Ozu dépeint les gens normaux

Présentée à Cannes Classics, Tôkyô Monogatari (Voyage à Tokyo,1953) de Yasujirō Ozu parfume de nostalgie la structure familiale japonaise. Historien du cinéma spécialisé dans le cinéma japonais et directeur du Festival international du cinéma de Las Palmas, Luis Miranda évoque ce grand classique restauré.
Sujet universel
Un couple âgé voyage à Tokyo pour rendre visite à ses enfants adultes mais, surchargés de travail, ces derniers ne prennent pas le temps de s’occuper de leurs parents. C’est une histoire universelle, teintée d’une conscience locale. Il n’y a plus de place pour le japon « lent » des anciens, mais la nostalgie chez Ozu n’est pas amère, elle est sereine et souriante car au bout, se trouve l’horizon de la mort. Il y a un personnage essentiel dans le film, la belle-fille, veuve de guerre, généreuse fille adoptive. Cette femme est l’enfant idéal de la tradition. Elle est la seule, elle qui a souffert, à hériter de la sérénité du père. La tragédie de la guerre s’infiltre subtilement dans les films d’après-guerre d’Ozu, et son sentiment de perte et d’acceptation nous émerveille.
Vie quotidienne
1953 et 1954 sont des années sublimes pour le cinéma japonais, entre Les Contes de la lune vague après la pluie de Kenji Mizoguchi, La Porte de l’enfer de Teinosuke Kinugasa ou Les Sept Samouraïs d’Akira Kurosawa. Ozu ne profite pourtant pas de cette vague dorée et son film n’est pas sélectionné dans les festivals européens, car son cinéma ne reproduit pas l’ambiance séduisante du passé féodal, mais une réalité du présent, du quotidien. Même si Ozu est aujourd’hui considéré comme un grand réalisateur au style unique dans sa compréhension du cinéma, il a toujours fait du cinéma populaire. Ce qui met Ozu au centre des regards, dans les années 1970, c’est la rigueur formelle et poétique de ses films d’après-guerre, comme celle de Voyage à Tokyo. Un style qui trouve son origine dans un apprentissage de studio, le grand studio Shōchiku, dans les dernières années du muet (1930-1935).
Studio Shōchiku : rigueur formelle
Une des spécialités Shōchiku des années 1930 était le shoshimin-geki, les "histoires des gens normaux" qui relataient la vie quotidienne de la petite bourgeoisie urbaine. On parlait d’un "Style Kamata" (le studio où Shōchiku produisait les films de ce genre), représenté par Ozu, Gosho ou le premier Naruse. Étaient montrées des situations quotidiennes dans des lieux reconnaissables, qui se décomposaient en détails qui fonctionnaient comme des pistes ou des clins d’œil : un recoin emblématique, un vélo appuyé sur le mur, un arrangement floral, des gants sur les braises… Ce style s’atténue avec l’apparition du sonore, mais Ozu le conserve et l’épure au point de le convertir en un système de découpage d’une émouvante régularité. Le montage « analytique » se transforme en un cinéma ascétique, léger, modeste et rituel.
Une scène
Le plan des paires de chaussons du couple âgé, devant la porte de la chambre de leur station balnéaire. Les chaussons sont un signe de présence et d’absence, ils signent une frontière entre le bruit extérieur, et le silence de ces personnes qui cherchent le sommeil. Le comique, la beauté et la tristesse, en une seule image. L’impermanence : en japonais, mono-no-aware ("le regret des choses").