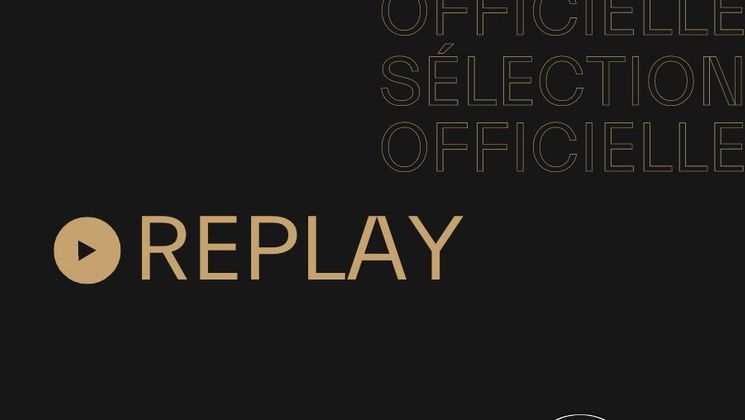Joyland, le regard de Saim Sadiq

Comment s’épanouir dans une société patriarcale et conservatrice ? La question habite le Pakistanais Saim Sadiq et traverse Joyland, son premier long métrage. Il y suit les tiraillements du dernier fils de la famille Rana, prié par ses parents de poursuivre la lignée familiale, alors qu’en secret, le jeune homme rejoint une troupe de danse érotique où il s’éprend d’une artiste transexuelle.
Comment vous est venue l’idée de ce film ?
Joyland est l’expérience la plus introspective de ma vie. J’ai eu l’idée de ce drame romantique en 2015. Je voulais interroger les concepts de désir, de masculinité et de féminité. Ce projet m’a permis de questionner ma place dans une société patriarcale à laquelle j’appartiens, qui m’a à la fois façonné et porté préjudice. Alors que je travaillais sur ce film, j’ai réalisé que les antagonismes de mes personnages étaient malheureusement bien plus universels que ce que j’imaginais.
Comment avez-vous travaillé sur ce film ?
Ma méthode de travail repose sur une grande préparation avec les chefs d’équipe. Joe Saade, Sana Jafri, Kanwal Khoosat et Zoya Hassan, ont joué un rôle essentiel dans la construction de ce film. Ensemble, nous avons construit un univers qui nous paraissait réel et nous étions tous sur la même longueur d’onde au premier jour du tournage.
Quelle était l’ambiance sur le tournage ?
Il y avait une certaine charge émotionnelle pendant le tournage car c’est un film sensible. Il est arrivé à plusieurs reprises qu’à la fin de la journée, un membre de l’équipe craque. Un jour, par exemple, alors que nous tournions une importante scène de danse, notre chorégraphe s’est retrouvé submergé et s’est mis à pleurer. Simplement du fait qu’il était possible de faire ce film dont le sujet est tabou. Dans ces moments-là, les membres de l’équipe ont su se serrer les coudes et se remonter le moral.
Quelques mots sur vos acteurs ?
Je pense que j’ai beaucoup de chance d’avoir eu cette formidable troupe d’acteurs, composée de non professionnels et de vétérans de la télévision et du cinéma pakistanais. Ils savaient que ce serait un film collectif qui avait besoin que chacun d’eux se mette parfois en retrait pour accorder la place nécessaire à un autre acteur et ils l’ont fait avec élégance.
Que vous a appris la réalisation de ce film ?
La plus grande leçon, c’est qu’il n’y a pas un seul et unique moyen de faire un film. Pendant longtemps, nous avons fantasmé une image de réalisateurs austères et égocentriques, qui exigent constamment respect et autorité. Mais ce projet m’a appris que faire un film peut servir à se débarrasser de son ego et montrer ses failles. Il m’a aussi appris que considérer ses collaborateurs – acteurs, chefs opérateurs, producteurs, directeurs artistiques, etc. – comme des artistes à part entière et prendre soin d’eux sur le tournage est peut-être l’une des conditions essentielles de la réalisation.
Quel est votre film culte ?
Mon film culte change chaque semaine mais ces derniers jours, j’ai beaucoup pensé au film Le Bonheur d’Agnès Varda. La première fois que je l’ai vu, j’étais en train de réfléchir à l’idée de Joyland. Ce sera sûrement le premier film que je verrai en rentrant après Cannes.