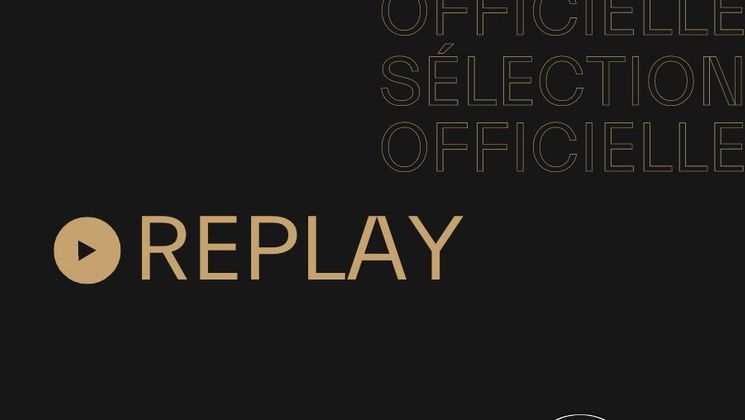Salem, le regard de Jean-Bernard Marlin

Dernier réalisateur à prétendre au Prix Un Certain Regard, Jean-Bernard Marlin présente Salem, son deuxième long métrage, cinq ans après le très applaudi Shéhérazade. S’il reste dans la cité phocéenne, le réalisateur explore cette fois le fantastique et nous montre une autre facette de Marseille à travers l’histoire d’amour contrariée entre Djibril et Camilla. Lui est comorien, elle est gitane, tous deux sont issus de quartiers rivaux.
Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de ce film ?
A Marseille, où se déroule Salem, on a tous des origines différentes. C’est vraiment un territoire de migrations avec de multiples façons de vivre. Ma mère est d’origine arménienne. J’avais un oncle gitan. Mon père était français, mais il a vécu dans une caravane très longtemps, c’est pour cela d’ailleurs que le motif de la caravane revient souvent dans le film.
Comment avez-vous travaillé sur ce film ?
J’ai tout storyboardé pendant deux ou trois mois pour avoir une vision claire de la mise en scène. La caméra est fixe la plupart du temps. Nous sommes d’une part, proches des personnages en respectant un certain classicisme , et d’autre part, on peut voir des percées visuelles expérimentales, comme des rêves. Comme pour la musique originale, le mot d’ordre était à l’image d’être un film-trip. C’est ce qui m’intéresse le plus : laisser libre court à l’inconscient, tout pouvoir remettre en question au moment du tournage, sur le plateau. Je voulais que le film soit une expérience sensorielle pour le personnage principal comme pour le spectateur, que tout le monde ait des visions.
Quelles ont été vos sources d’influence ?
J’adore les tragédies, notamment shakespeariennes. Ça fait clairement partie de mes références premières. Le début du film est sciemment construit comme une version moderne de Roméo et Juliette. Dans la tragédie, la fatalité pèse sur les personnages du début à la fin. Djibril est un personnage marqué par un « défaut » tragique : il voit le monde différemment de tous les autres. Ce qui le contraint à avoir des réactions imprévisibles, irrationnelles et donc parfois perçues comme dangereuses.
Quelques mots sur vos interprètes ?
Nous avons fait un casting sauvage de dix mois. Ce film est une première pour chaque comédien. Le point commun qu’ont tous ces jeunes gens et acteurs non professionnels, est que, comme mes personnages, ils vivent tous dans le moment présent. C’est un présent qui n’est pas toujours facile. Dalil Abdourahim et Maryssa Bakoum sont confrontés, comme leurs personnages Djibril et Camilla, à des situations sociales et familiales parfois difficiles. Ce sont des adolescents qui dégagent eux aussi une grande part de maturité d’où l’on décèle encore quelque chose de l’enfance.
Qu’aimeriez-vous que l’on retienne de votre film ?
La transmission, c’est le seul mot idéal qui me vient. Transmettre est le verbe que j’utilisais pour parler de mon film à mon équipe, c’était le plus important pour me rappeler à moi-même ce que je voulais faire. Que transmet-on à ses enfants quand on a des troubles psychiques ? Peut-on inoculer sa folie, ses délires ? Cela me passionne. Dans Salem, la maladie, mentale, physique, ou la croyance en un monde invisible, est transmise d’un père à sa fille, comme s’il s’agissait d’un virus.