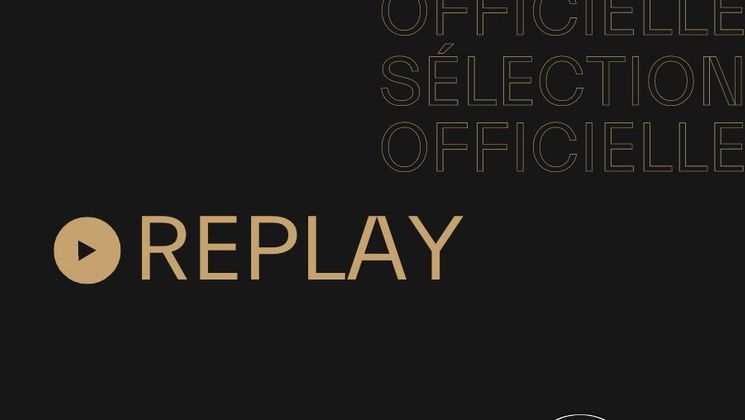Varoonegi, rendez-vous avec Behnam Behzadi

Tout part d’un jour de forte pollution à Téhéran. Les problèmes respiratoires de la maman de Niloofar (Sahar Dowlatshahi) et leurs conséquences l’incitent à s’affirmer dans sa famille. Au Certain Regard, le réalisateur iranien Behnam Behzadi signe, avec Varoonegi, son troisième long métrage.
Racontez-nous la genèse de votre film
Il y a quelques années, un jour de forte pollution à Téhéran, j’ai vu une jeune fille qui, comme beaucoup d’autres personnes, portait un masque sur le nez, et marchait sur le trottoir. Quand elle est passée près de moi, j’ai remarqué qu’elle était en sanglots, elle n’avait pas conscience de ce qui se passait autour d’elle. Je me suis dit qu’elle utilisait peut-être ce masque pour se protéger des regards lourds de reproche de la société. Après quelques années, son image est toujours très nette dans mon esprit. Une image qui m’a accompagné dès ce jour de grande pollution et qui a marqué le point de départ de ce film.
Quelques mots sur vos acteurs ?
Travailler avec des acteurs professionnels pour la première fois fut une expérience nouvelle et formidable. Sahar Dowlatshahi était mon premier choix pour le rôle de Niloofar. Elle n’est peut-être pas très connue du grand public, mais en Iran elle est l’une des actrices de théâtre et de cinéma les plus reconnues. Pendant le tournage, Sahar écoutait la musique préférée de Niloofar, une façon pour elle d’approcher le rôle au plus près.
J’ai parlé à Ali Mosaffa du rôle de Farhad quand j’écrivais le scénario. Depuis vingt ans, il travaille avec les plus grands noms, notamment dans Le Passé pour Asghar Farhadi. Il est aussi scénariste, réalisateur et producteur. Dans Varoonegi, Farhad est d’une certaine façon à l’opposé de ses rôles habituels, c’était donc un challenge pour lui comme pour moi.
Vos sources d’inspiration ?
Jeune adolescent, je suis tombé amoureux du cinéma, du moins de l’image que je m’en faisais. C’était quelques années après la révolution Islamique, et les salles de cinéma et la télévision ne passaient que des films iraniens, ou une petite sélection de films étrangers, toujours les mêmes. Les films étaient une marchandise de contrebande, un rêve inaccessible.
Puis j’ai découvert la littérature. Contrairement aux films, les livres étaient disponibles. On trouvait des livres qui avaient été traduits avant la révolution. Tout à coup, j’ai compris que j’étanchais ma soif de cinéma en lisant des romans étrangers. Quelques années plus tard, quand on a eu l’autorisation d’avoir des lecteurs vidéo et qu’il y a eu plus de films en circulation, l’industrie underground a ressurgi. Les films venaient de partout et mon ancien amour pour eux est revenu. C’était un tournant.
Quel regard portez-vous sur le cinéma de votre pays ?
Le cinéma occupe une place étrange en Iran. Quelques milliers de courts-métrages et de films documentaires et près de 250 longs métrages sortent chaque année. Une petite partie de ces films appartiennent aux circuits de distribution internationaux. Tout ce cinéma est très vivant. L’Iran est l’un des rares pays où vous pouvez encore voir de longues files d’attente devant les cinémas, des salles bondées…
En dehors de cette frénésie productive, il y a le cinéma indépendant d’Iran, des gens comme moi qui font leurs propres films avec leurs propres investissements, ou grâce aux faibles supports financiers extérieurs au gouvernement. C’est éreintant mais je suis fier d’être resté indépendant.