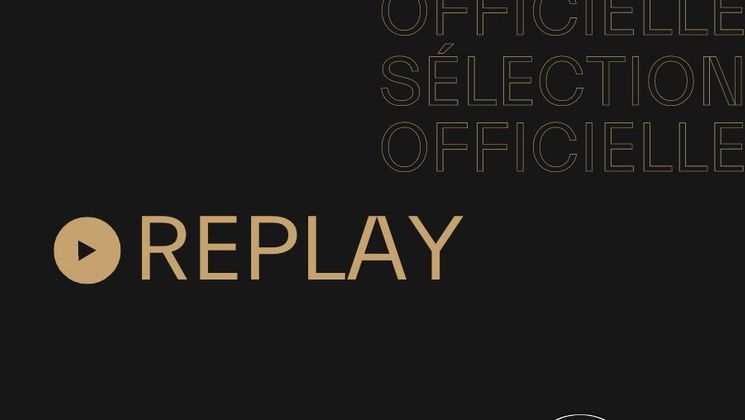Léonor Serraille interroge la (dé)construction familiale dans Un Petit Frère

Rose, d’origine ivoirienne, arrive en France et emménage en banlieue parisienne avec ses deux fils, Jean et Ernest. Après Jeune Femme, son premier long métrage récompensé de la Caméra d’or en 2017, Léonor Serraille raconte dans Un Petit Frère la construction et la déconstruction d’une famille, de la fin des années 1980 à nos jours.
Qu’est-ce qui vous a donné l’idée de ce film ?
Après Jeune femme, j’hésitais entre diverses envies mais je me sentais très « en surface » des sujets que j’abordais. Voyant mes difficultés, ma productrice Sandra da Fonseca m’a dit cette phrase toute simple : « fais ce deuxième film comme si c’était le dernier ». Cela a tout débloqué. J’avais souvent eu envie d’écrire autour de la vie du père de mes enfants, que je connais depuis que j’ai 17 ans. Mais je n’osais pas. Il m’a donné une carte blanche totale en me suggérant de prendre possession du sujet, sans coller à lui, et d’envisager cette histoire comme un récit d’aujourd’hui. J’ai l’impression que raconter cela, c’était aussi combler certains manques que j’associe à un désir de spectatrice. J’étais touchée par des éléments liés à sa venue en France lorsqu'il était enfant. Il y avait aussi des ponts avec mes ressentis en tant que mère et les questions que je me posais sur ma propre famille à ce moment-là. Le scénario s’est écrit avec une sensation de nécessité soudaine. Cette histoire commençait à s’emmêler dans ma tête, il fallait la poser hors de moi, la comprendre et peut-être la sublimer.
Après un portrait de femme, vous vous attelez au portrait d’une famille. Qu’est-ce qui vous a intéressé ?
Je voulais me tenir la plus proche possible d’un trio de personnages. C’était une sorte d’exploration à tâtons. En écrivant, j’ai réalisé que le parcours spécifique de Rose, Jean et Ernest pouvait également se voir comme une sorte de livre ouvert, dans lequel n’importe qui pourrait peut-être se projeter. C’était un mouvement paradoxal pour embrasser leur singularité et en même temps les ouvrir totalement. C’est avant tout un film qui interroge la famille, ce qu’elle nous permet, ce qu’elle nous enlève, ce qui se transmet ou ne se transmet peut-être pas. A toutes les phases du travail, il était crucial de chercher à rendre compte d’une complexité, car la construction d’une personne est complexe et les questions d’identité sont complexes. Il y avait un désir de comprendre certains états intérieurs : la force et le besoin de vivre intensément en arrivant en France, mais aussi la solitude et les difficultés de se sentir « légitime » dans ce qu’on fait. Il y avait aussi le fait que quand on a passé la plus grande partie de sa vie en France, on ne s’intègre pas, on fait corps avec un pays depuis toujours ou presque toujours. Je voulais plus interroger que montrer. Je ne détiens pas la vérité sur ces sujets-là. Par contre, ils m’intéressent et font partie de ma vie, de mon pays. J’avais envie de les aborder dans un film aussi romanesque que possible, finalement, à l’image de la vie de Rose, Jean et Ernest. Il y avait le besoin d’un autre éclairage.
Comment vos personnages ont-ils évolué au fur et à mesure de l’écriture du scénario ?
Du réel, j’ai gardé la trame, des points de repère précis, les lieux. Les personnages de Rose, Jean et Ernest, sont plus fictionnels. C’était la clé pour oser me plonger dans l’écriture. Ils ont évolué, forcément, de l’écriture au montage. Comme lorsqu’on fait connaissance avec quelqu’un : on garde une pudeur, mais ensuite on se connaît, alors on ose un peu plus. Rose s’est révélée être une figure de femme extrêmement moderne, avec une soif de vivre et un désir de liberté. Il y a une forme d’insoumission en elle qui me parle fortement. Et ses fils, Jean et Rose, sont habités par leur passé ou leur présent de façon différente. Ils ont une sensibilité commune tous les trois, et pourtant ils n’ont pas les mêmes armes ou la même façon d’absorber les évènements. Il était important de toujours trouver l’équilibre. Ce ne sont pas des idoles. Ils sont aussi imparfaits. Ils portent des failles et font des erreurs, comme tout le monde, et c’est là que cela devient intéressant je trouve : garder ce cap, quand bien même, en écrivant, on aime follement son personnage.
Pourquoi avoir choisi de bâtir votre film sur trois temporalités différentes ?
Quand on a cinq ans, notre regard d’enfant sur notre mère n’est pas le même qu’à vingt ou trente ans. Comment regarde-t-on, comment ce regard traverse le temps ? Parfois, un geste banal qu’on effectue nous ramène à ce geste que notre mère effectuait à l’identique. Le temps se compresse, la vie semble soudain trop courte. Ces trois temporalités permettent d’explorer les échos possibles et les brutales accélérations du temps. On a la possibilité de poser une structure assez « rigide », mais également de sortir aussi hors de la mécanique du scénario pour ouvrir totalement le film et s’aventurer dans l’intimité de chacun. On peut brouiller les pistes, et en même temps, mettre en valeur des moments essentiels. La structure en trois parties est dialectique. Elle pousse en avant.
Au sein de cette famille, vous vous attardez davantage sur le grand frère, d’abord jeune homme, et le racontez au gré de ses rencontres. A quel point nos rencontres forgent-elles ce que nous sommes, selon vous ?
On pose souvent la question du mérite, qui est culpabilisante, comme si tout était relié à notre volonté ou notre faculté de faire les choses bien ou mal. On est bien-sûr forgés par les autres, mais aussi par nos activités, notre environnement. Cela ne veut pas dire qu’on n’a pas notre patte à nous, notre unicité, notre faculté d’agir. Les personnes qu’on rencontre au fil de la vie ont parfois un mot, un geste, une attitude qui peut nous changer profondément, en bien comme en mal.
« Nous avions envie de traverser le temps et les époques sans pour autant faire trois films ».
Il y existe un lien important entre vos personnages et leur mère. Au fur et à mesure de ses histoires d’amour avec des hommes plus ou moins sympathiques, ces enfants, et en particulier l’ainé, vont forger leur âme. En quoi était-ce intéressant de développer le lien maternel de vos protagonistes ?
Entre le moment où l'on serre un enfant dans nos bras à la naissance, en fusion absolue, et le moment où il est devenu un homme, que va-t-il se passer ? Comment évoluera notre relation, le regard sur chacun ? On peut aimer de multiples façons son enfant, son parent. Même dans la distance ou la difficulté. Le lien entre Rose et ses fils structure le film. C’est un moteur et c’est aussi un lien mouvant et protéiforme. Cela m’intéressait car au cinéma, plus c’est intériorisé, plus on peut déployer des outils pour partir en exploration.
Votre film aborde également, en se déployant sur tente ans, la question d’être d’origine subsaharienne dans la France d’aujourd’hui. Qu’avez-vous souhaité souligner ?
Durant le montage, j’ai lu Afropea de L. Miano. A un moment, elle écrit : « l’identité n’est pas dans la couleur, elle est dans le vécu ». C’est un livre important. Ces questionnements comptent plus que jamais parce que l’on est dans une période de tension, de rejet de l’autre et de fermeture et qu’il est nécessaire de réfléchir à ce qui est possible de faire, pour l’avenir. Ce que je ressens, ou peut-être ce que j’aimerais qu’on ressente, c’est que Rose est venue en France, qu’elle a donné et qu’elle a apporté. Elle n’a pas « pris » et elle n’a pas « remplacé ». Elle n’a pas dénaturé.
Visuellement, mais aussi en termes de rythme, quels étaient vos souhaits au moment d’aborder le tournage ?
Nous avions envie de traverser le temps et les époques sans faire pour autant trois films. Je me souviens avoir très peu parlé de références à Hélène Louvart, ma directrice de la photographie. Peut-être deux films, Elvira Madigan de Bo Widerberg, et Un ange à ma table de Jane Campion. Je souhaitais au départ filmer en pellicule. Mais j’avais peut-être pris des habitudes sur Jeune femme et après avoir beaucoup hésité j’ai décidé, devant ce film assez différent du premier, de garder ce point d’ancrage. Hélène a su trouver, pour chaque époque, comment rendre le support le plus organique possible et au final, j’ai l’impression qu’on a eu beaucoup de liberté pour inventer à chaque instant. C’est ce que je recherche sur un plateau : un espace de recherche ou rien n’est jamais figé. Le film parcourt pas mal d’années : il était donc important d’oser varier les rythmes et les dispositifs pour ne pas s’enliser et garder une fraîcheur, un dynamisme. Hélène avait comme moi le désir que les personnages puissent être accueillis dans des couleurs un peu nouvelles. Visuellement, c’est aussi l’interprétation d’une histoire et du passé. D’une certaine façon, on filtre, alors on peut pousser un peu les choses. On ne cherche pas à coller au réel.
Comment s’est déroulé le tournage ?
Nous avions de bonnes conditions de tournage. Le film a eu un financement qui a permis de faire les choses telles qu’on les souhaitait. Nous avons tourné neuf semaines, dont plusieurs en Normandie. A une grosse poignée de scènes près, nous avons pu suivre le scénario de façon assez chronologique et pour moi, cela a été crucial car avec l’équipe et les comédiens, nous avons pu sans cesse nourrir, dans la durée, le cœur des scènes, en fonction de ce qui avait été tourné ou pas. Ce tournage a été très intense. Être accompagnée par Hélène Louvart a été une aventure réellement forte. Difficile de choisir un seul moment, ou alors si, mais c’est personnel, lié à des émotions que j’ai pu ressentir devant une prise. J’ai pensé que j’avais peut-être fait finalement ce film pour comprendre cette minuscule chose-là. Je me suis sentie heureuse et stupide à la fois.
Un mot sur votre casting : comment l’avez-vous trouvé ?
Avec Youna de Peretti, on a mené un casting que j’ai trouvé passionnant. On souhaitait d’abord trouver la maman, et Annabelle Lengronne a surgi comme une évidence, avec beaucoup de délicatesse. J’ai été émue par ma rencontre avec elle, et sans pouvoir l’expliquer tout à fait, elle est entrée dans la pièce comme si elle avait déjà lu le scénario. C’est quelqu’un d’une grande expressivité, qui raconte beaucoup de choses sans effets. Stéphane Bak aussi a été une évidence, avec sa forte présence, son implication et son souci de ne jamais rien trahir. Le dialogue avec lui était riche, et son regard sur le film a beaucoup compté pour moi. J’ai l’impression qu’il a pu saisir quelque chose de très intérieur, une retenue et en même temps une forme de lâcher-prise. Ahmed Sylla était dans un registre un peu différent que d’habitude. C’était une très belle surprise de le rencontrer. Il apporte un éclat et une tonalité au personnage. Ahmed travaille avec précision et élégance. Tout semble facile avec lui. Pour préparer le tournage, on beaucoup lu, discuté, mais je ne voulais pas trop avancer non plus avec eux car j’avais peur que trop de choses se passent en répétition sans l’équipe. Je ne sais pas exactement comment je dirige, d’ailleurs je n’aime pas trop ce mot. Pour moi, on discute et on cherche. C’est très instinctif. Je ne donnais pas de texte aux enfants. Nous étions en situation et comme ils savaient ce qui se passait dans chaque scène, je pouvais leur demander beaucoup de choses. Je les sentais disponibles, en confiance. Annabelle passait du temps avec eux régulièrement avant le tournage, c’était leur maman du mercredi.