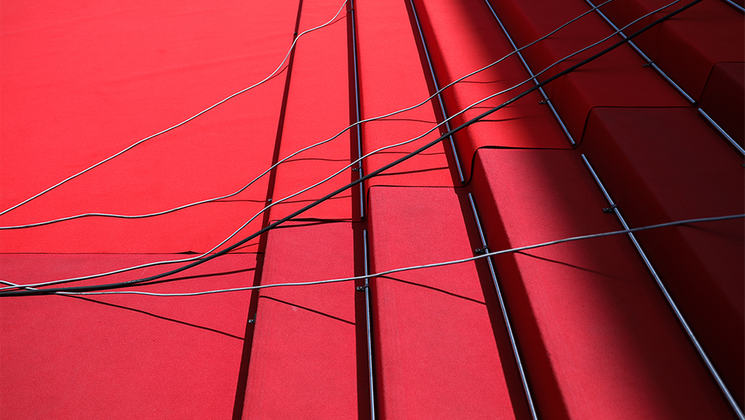Rencontre avec Mati Diop, membre du Jury des Longs Métrages

Atlantique, son premier long métrage, lui a valu le Grand Prix en 2019. Dans les rangs du Jury, Mati Diop impose un regard exigeant sur le cinéma. Plasticienne de formation, exploratrice des supports et des genres, la réalisatrice et actrice nous confie sa vision du cinéma.
Vous avez reçu le Grand prix en 2019 pour Atlantique. Qu’est-ce que cette récompense a changé dans votre vie de cinéaste ?
Tout et rien. Tout, parce que ça a été un énorme tournant, une reconnaissance mondiale. J’ai toujours été soutenue par divers festivals, leur reconnaissance critique a construit mon chemin. Dans le geste cinématographique que représente Atlantique, l’ambition était de s’adresser au monde à partir de Dakar, avec une histoire que j’ai voulue universelle. Cannes a eu un effet nucléaire, ça été un choc immense, je ne m’attendais à rien.
Et ça n’a rien changé, disiez-vous.
Ça m’a mise dans une position où j’ai reçu beaucoup de propositions, une position de force, mais ce n’est pas pour autant que je ne suis pas la même cinéaste. Je me pose les mêmes questions sur mon medium, ce que je veux raconter et comment. Même si ça me donne plus de possibilités et une crédibilité, ça n’a absolument pas changé mes questions et mes doutes sur la création pure. Et je tiens à préserver cette vulnérabilité.
Entre Atlantiques, le court, et Atlantique, le long métrage, que s’est-il passé dans votre esprit ?
Le fil conducteur, c’est la question du territoire. En 2009, ça parlait déjà d’un jeune homme qui se confiait à ses deux amis au sujet de la traversée en mer jusqu’en Espagne. J’ai été assez proche de quelques personnes prises dans cette situation. Ça faisait écho à mon rapport à Dakar et à l’Europe. Dix ans plus tard, tout ce que je n’ai pas pu exprimer dans le court, je l’ai développé en fiction avec une dimension fantastique. Le court métrage a eu une reconnaissance de la profession en festivals mais ça ne me suffisait pas. Je ne voulais pas m’adresser au milieu du cinéma mais au monde.
Il y a quelques jours, le réalisateur Mark Cousins qui présentait The Story of Film: a New Generation nous disait l’admiration qu’il vous porte et l’importance du cinéma sénégalais dans l’histoire du cinéma. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Je ne peux qu’être touchée par sa reconnaissance. Quant au cinéma sénégalais, c’est toujours pour moi difficile d’en parler en général. Je ne connais pas tout, il y a des films qui m’ont marquée et d’autres moins. Le cinéma qui m’a faite, dont je suis l’une des héritières, c’est celui de Djibril Diop Mambéty. Pas seulement parce que c’est mon oncle mais parce que son cinéma m’a marquée. Je suis plus sensible à son cinéma qu’à celui d’Ousmane Sembène, que je connais moins bien.
Quel rapport entretenez-vous avec le cinéma africain ?
Je n’ai jamais voulu me sentir obligée de regarder tous les films africains parce que j’étais à moitié sénégalaise. Adolescente, le cinéma africain me repoussait presque. Hormis le cinéma de mon oncle et les films du Nigérian Moustapha Alassane, qui a fait un film que j’adore, Le Retour d’un aventurier. Et quelques films d’Abderrahmane Sissako comme En attendant le bonheur et Bamako, un chef d’œuvre. Le cinéma africain qui me touche est celui qui sort de certaines traditions, d’un rapport parfois moralisateur. J’aime les films de Mambéty parce qu’ils sont subversifs, intransigeants avec la question coloniale. J’ai adoré Touki Bouki (Le voyage de la hyène), j’ai été très intéressée par La Noire de…
Vous filmez souvent de nuit, à la lumière des néons, de la lune ou dans la quasi pénombre. Qu’est-ce que la nuit a de cinématographique ?
En tant que spectatrice, il y a des moments de nuit qui m’ont contaminée. Je pense à des ambiances nocturnes dans des films de Claire Denis, Michael Mann, John Carpenter… Au-delà du cinéma, à Dakar, la nuit a toujours exercé une forme de fascination sur moi. C’est d’abord sonore. Par ailleurs, quand j’ai commencé à y faire des films, j’étais plus à l’aise à l’idée de tourner de nuit, je voyais sans être vue, il se passait quelque chose de magnétique, un peu sacré. C’est comme si la ville se transformait en quelque chose de très cinématographique. J’ai presque un sentiment amoureux pour cette ville la nuit.
Comment concevez-vous le cinéma post Covid ?
Je me sens chanceuse de regoûter à des choses belles de la vie. Ce que je vis ici, voir trois films par jour avec des gens formidables et talentueux, c’est une sorte de paradis. Mais on n’est pas sortis de cette période. Ça a généré une crise sociale profonde et les conséquences sont déjà là. Ce qu’il se passe donne la sensation qu’on a basculé de siècle. Je le ressens très fort et ça contamine ma manière de penser, quotidiennement, et mon travail, dans le sens où tous mes projets sont en écho avec ce qu’il se passe maintenant. C’est de maintenant dont j’ai envie de parler et ça bouscule mon cinéma.